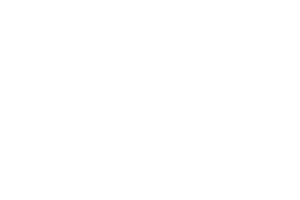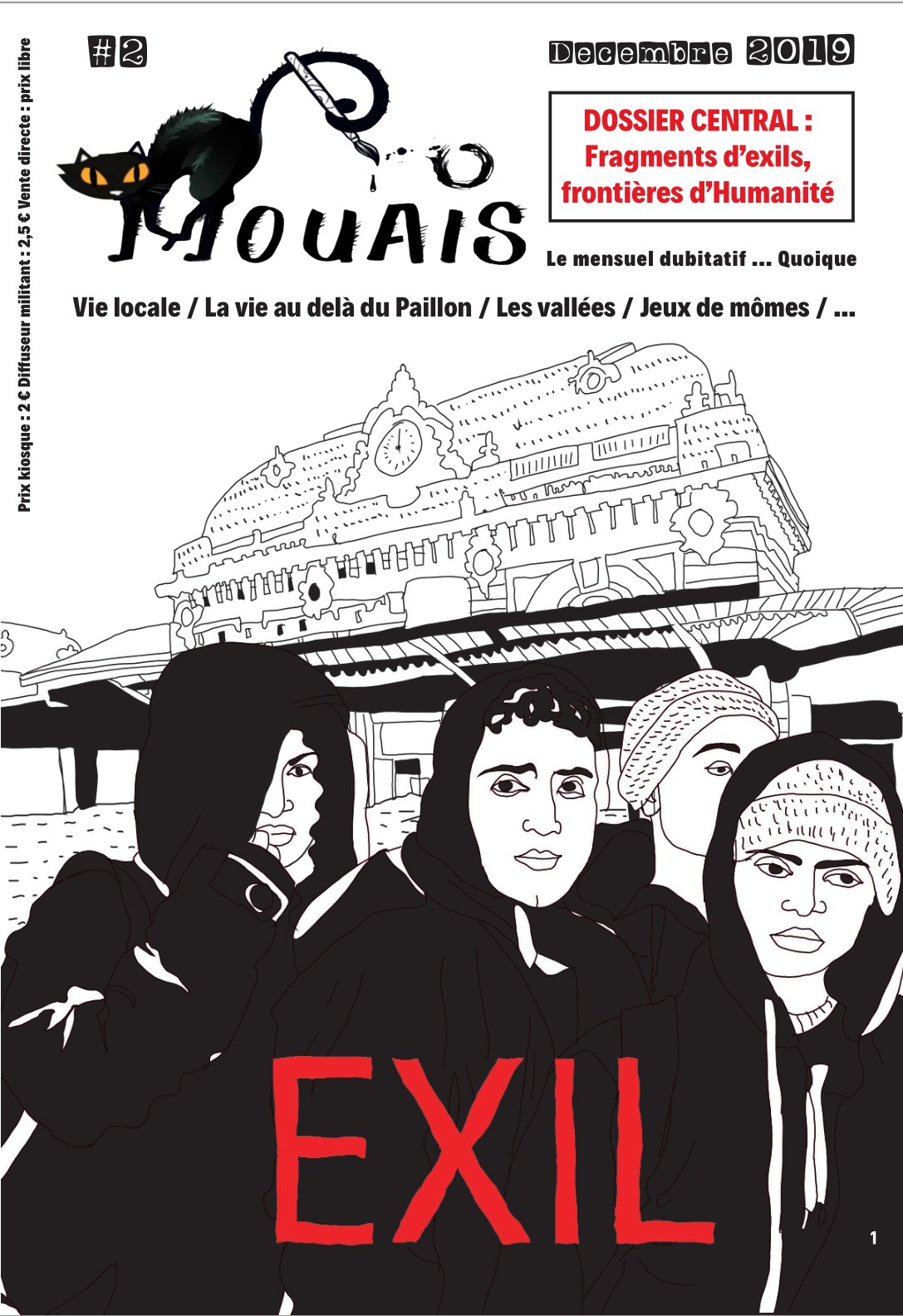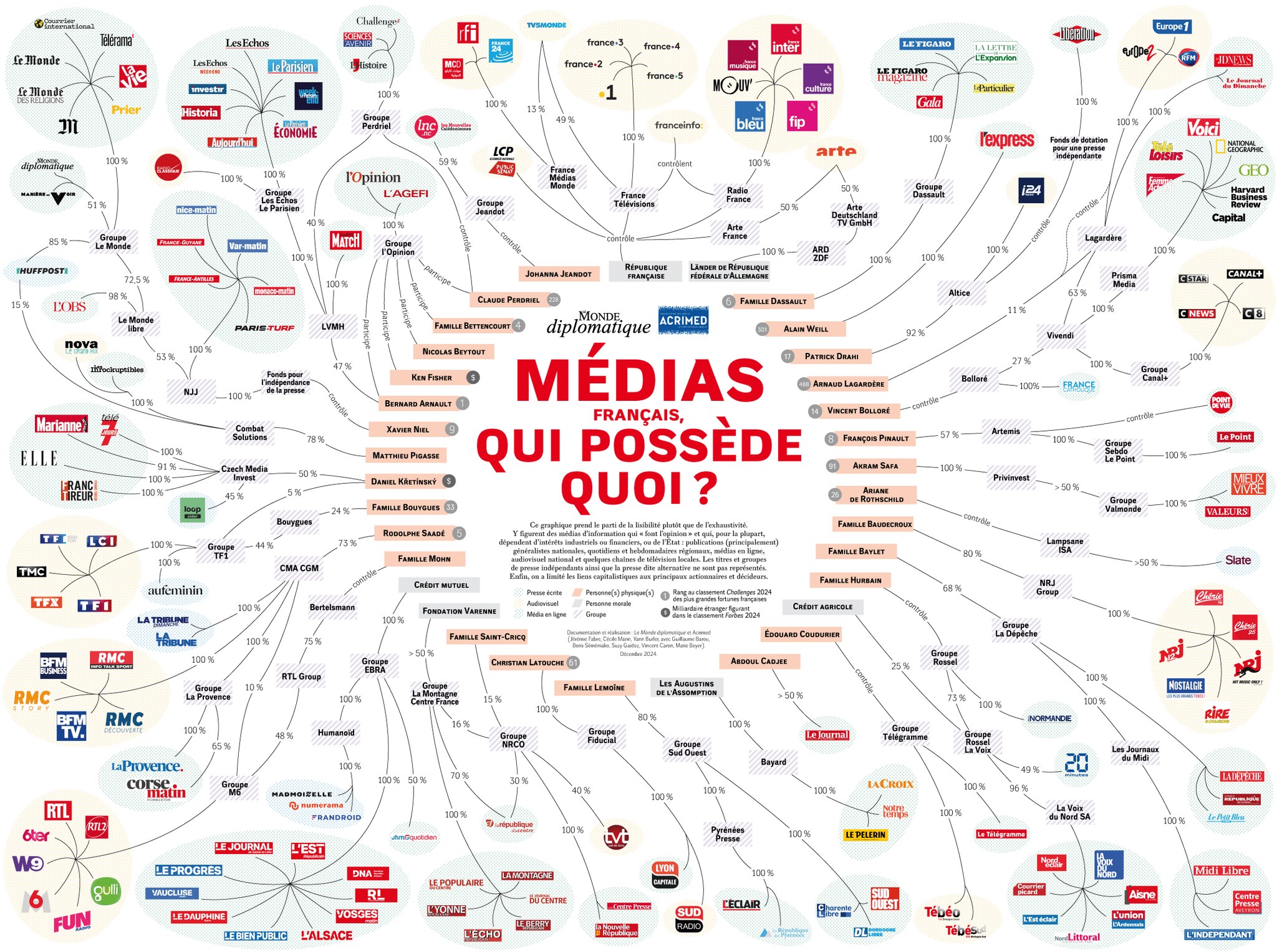Une lutte de terrain - foot feminin partout, egalite nulle part ?
S’il ne suffit pas de se déclarer féministe pour le devenir, il ne suffit pas non plus de se déclarer en faveur de la non-mixité pour en accepter les conditions et les effets réels. La preuve par le terrain, avec ce récit de l’inclusion ratée d’une équipe de foot féminine au sein d’un club militant.
***
La féminisation progressive du football n’empêche pas le maintien de fortes inégalités dans la discipline. L’attention médiatique se concentre souvent sur la lutte pour l’égalité salariale entre les sélections nationales masculines et féminines. Or dans le foot amateur, loin des radars des commentateur·ices sportif·ves, se mènent quotidiennement d’autres luttes pour l’égalité. L’engouement pour la Coupe du monde féminine en 2019 avait laissé espérer la fin d’une ère où le consultant de Canal + Pierre Ménès pouvait affirmer librement que les footballeuses sont « de grosses dondons trop moches pour aller en boîte »1. Peu de temps après, 86 joueuses âgées de 5 à 45 ans claquaient pourtant la porte d’un club de foot situé dans le Tarn2. Après plusieurs tentatives de négociation avec la direction, elles sont parties en dénonçant les mauvaises conditions de leur pratique sportive, quand leurs homologues masculins bénéficiaient d’un traitement all inclusive de la part du club.
Quelques mois plus tard, c’est un club parisien qui a perdu l’intégralité de ses joueuses. Les footballeuses amatrices, adultes de tous niveaux, avaient répondu aux appels à la création d’une formation féminine dans un club qui ne comptait jusque-là que des équipes masculines. Le hic ? Le club en question se présente comme rassemblant des personnes qui combattent les discriminations liées au genre, parmi d’autres luttes. Promoteur d’un football populaire et ouvert à tou·tes, il se positionne contre la criminalisation des supporter·ices et les violences policières, sous l’étendard des luttes antifascistes, antiracistes et anticapitalistes.
Une autogestion chaotique, les débordements d’une culture viriliste ancrée dans le militantisme supporter et de grandes difficultés à reconnaître le caractère structurel des oppressions portant sur les femmes et les minorités de genre ont alimenté un continuum sexiste qui a fini par exaspérer le groupe de joueuses, dont j’ai fait partie. Contre un silence qui contribue à banaliser des situations parfois intolérables, je reviens sur cette expérience de mon point de vue – celui d’une femme blanche, diplômée, issue des petites classes moyennes. La violence qui a pu l’entourer et la volonté de la réinscrire dans une réflexion sur l’articulation des luttes féministes avec les luttes anticapitalistes et antifascistes en contexte sportif m’amènent toutefois à taire le nom du club. Retour sur un engagement qui aura durablement affecté des trajectoires personnelles, professionnelles et militantes.
Tout le monde déteste le purple washing
L’histoire heurtée du foot féminin rappelle que la conquête des stades par les femmes est encore loin d’être effective, ce qui en fait un terrain privilégié des luttes antisexistes. S’il ne s’agit pas de condamner le foot au nom du sexisme, du racisme ou de l’homophobie qui le caractérisent trop souvent, il agit comme « un miroir grossissant »3 des clivages qui traversent notre société. En cela, il n’est pas imperméable à divers phénomènes de récupération, comme l’idée selon laquelle il suffirait d’afficher du « féminin » afin de se présenter comme féministe, que dénonce l’appellation de purple washing4.
Les espaces militants d’un bout à l’autre du spectre de la gauche n’y sont pas imperméables non plus. Face à cela, l’auto-organisation des groupes féministes et les luttes en non-mixité de genre, racisée ou LGBT+, visant à ce que les groupes minorisés se réapproprient leurs revendications, sont moins le résultat de volontés sécessionnistes que le produit de logiques d’exclusion et de disqualification de la parole politique des femmes.
Aujourd’hui, la dynamique de #MeToo et la floraison d’initiatives à la fois féministes et queer, LGBT+, antiracistes et de défense des travailleur·euses du sexe, renouvellent les appels à une remise en question idéologique et pratique au sein des espaces militants. Les attentes sont d’autant plus grandes que l’on se rapproche de collectifs qui entendent lutter contre les discriminations.
C’est dans ce paysage en ébullition que le club dont j’ai fait partie a répondu avec enthousiasme à la demande d’une joueuse qui souhaitait reprendre le foot en proposant la création d’une équipe féminine. L’envie de me remettre au sport, de faire partie d’une équipe et de partager la vie sociale propre au football a fini par me convaincre d’y participer. La possibilité d’associer la pratique sportive et les luttes sociales a été décisive. Le club bénéficie en effet d’une certaine aura parmi les clubs de foot militants et autogérés en Europe. Il fait écho au modèle des clubs italiens de calcio popolare5, et revendique une réappropriation des clubs de foot par les supporter·ices et les joueur·ses, qui font partie intégrante de la gestion du club.
Il s’ancre également dans un mouvement plus ample de repolitisation du football amateur en France, marqué par la création, ces dix dernières années, d’équipes qui affichent clairement leur dimension politique et sociale (Les Dégommeuses, Les Hijabeuses, Paris d’exil, Football du peuple…). Tout me semblait indiquer que nous allions pouvoir trouver notre place dans cet espace, loin des craintes de ne servir que de représentation féminine ou de caution féministe.
« Faire l’effort de s’intégrer »
L’équipe féminine, créée début 2019, est arrivée à un maximum d’une trentaine de joueuses de 17 à 33 ans. Le club finançait une partie des frais liés aux compétitions et le matériel. Les entraînements, préparés et menés par l’une d’entre nous, se tenaient sur un terrain partagé avec l’une des deux équipes masculines. Je garde un bon souvenir de l’exercice sportif, de la manière dont je retrouvais un rapport plus apaisé à mon corps, de la réussite de nouveaux gestes, des petites victoires sur soi – plus rarement sur les autres, soyons honnêtes. Sur le terrain, nous trouvions notre place.
Hors des terrains, la situation était plus complexe. Une partie des membres du club a demandé que des joueuses, au-delà de leur pratique du foot, s’impliquent dans l’association. La difficulté à mobiliser est un classique de la vie associative : comment répartir la charge de travail (bénévole), tout en respectant le droit de chacun·e de choisir son degré d’investissement ? Ce questionnement s’est ici accompagné d’un double standard6. Comme dans de nombreux clubs, la majorité des joueurs pratiquaient le foot sans s’impliquer dans la gestion du club et ses actions militantes, ces deux dernières activités étant principalement le fait des coachs et des supporter·rices. Cette division du travail est justifiée par le principe selon lequel les joueurs investissant déjà beaucoup de temps dans les entraînements et les matchs, il est difficile d’exiger de leur part un investissement supplémentaire dans les activités annexes.
Pour l’équipe féminine, c’est au contraire une implication des joueuses dans la structure associative qui fut demandée. Nous nous organisions sur le plan sportif. Sur le plan militant, si nous voulions porter des messages politiques spécifiques au foot féminin ou aux luttes féministes, il fallait nous en charger nous-mêmes, au nom de cette spécificité. Ce principe de prise de parole par les premières concernées est on ne peut plus recevable. Son application s’est révélée plus délicate.
Réfléchir à nos envies et aux revendications que nous voulions porter en tant qu’équipe impliquait de nous organiser, au moins dans un premier temps, au niveau de l’équipe. Or ce niveau d’organisation se télescopait avec la structure de l’association, qui demandait que nous nous répartissions individuellement dans différentes commissions thématiques (tribune, communication, politique…) en plus de celle spécifiquement dédiée à l’équipe féminine, déjà investie par des joueuses et dont le périmètre d’action était mal défini. La structure en commissions thématiques avait en effet pour conséquence que les décisions prises par cette dernière étaient amenées à être discutées dans les autres commissions – dans lesquelles nous étions peu représentées et où, du même coup, disparaissait la liberté de positionnement et de parole de l’équipe féminine.
C’est sur ce plan que sont apparues les dissensions les plus importantes, qui à ce jour laissent une série de questions ouvertes. Comment envisager la prise de parole et l’auto-organisation d’un groupe non-mixte à l’intérieur d’une structure mixte dès lors que cette dernière passe au crible chacune des positions de ce groupe, niant de fait son existence politique ? Comment aller au-delà des injonctions contradictoires faites aux nouvelles entrantes, leur demandant de s’impliquer plus fortement pour avoir une plus grande légitimité tout en refusant de voir que les conditions d’accès à cette légitimité ne sont pas les mêmes pour tou·tes ? En d’autres termes, comment faire en sorte que l’inclusivité soit autre chose qu’un appel consensuel ou un vœu pieux ?
Les initiatives de l’équipe, prises dans ces contradictions, ont donné lieu à une série de conflits. Ils se sont notamment cristallisés autour de la Coupe du monde féminine de 2019, organisée par la Fédération internationale de football association (FIFA).
La Coupe du monde pose la question de la visibilité du football féminin et du positionnement à adopter quand la seule initiative médiatisée est celle d’un grand barnum mercantile prompt à faire taire les voix discordantes7. Cette question stratégique dépasse largement le cadre footballistique : faut-il récuser les initiatives féminines dominantes si ce refus implique l’invisibilité totale des femmes dans un milieu donné ? Opposer enchantement et invisibilisation est une impasse, dans la mesure où un indispensable regard critique sur ce spectacle promouvant le football féminin ne se résume pas nécessairement à une compromission aveugle avec l’ordre établi.
Une proposition d’action lors d’un match de la Coupe du monde où se rendaient une douzaine de joueuses s’est pourtant retrouvée écartée. Nous avions évoqué l’idée d’un visuel ou d’un message (« Love Football, Hate Sexism ») déployé dans les tribunes et accompagné d’un communiqué expliquant notre positionnement critique à l’égard de la façon dont est promu le foot féminin par les instances nationales et internationales. C’était hors de question, nous a-t-on répondu, si nous ne prenions pas également position contre la FIFA à l’intérieur du stade – autrement dit si nous ne menions pas une action plus « dangereuse » qui, dans le meilleur des cas, faisait courir le risque de se faire expulser des gradins manu militari (et dans le pire des cas, pouvait nous valoir une interdiction de stade). Afin de trouver un compromis, plusieurs d’entre nous ont intégré la commission dédiée à la tribune, à laquelle nous avons fait une proposition écrite et argumentée. Mais au final, des accusations de complaisance avec le foot business et son purple washing, la menace qu’une partie des supporters quittent le club si nous faisions cette action et le mépris de notre proposition ont eu raison de notre envie de nous mobiliser. Ou plutôt : nous étions libres de le faire, mais interdites de le faire au nom de l’équipe, et donc du club.
La communication, pour des associations et des collectifs aujourd’hui extrêmement dépendants des réseaux sociaux, est un énorme enjeu. Nous l’avons appris à nos dépens à la suite de l’ouverture d’un compte Twitter de l’équipe sans validation préalable par la hiérarchie du club, et pour lequel un contrôle des publications par des membres qui s’occupaient des réseaux sociaux a été exigé. Ayant refusé ce contrôle après des épisodes d’ouverture et de clôture temporaires, nous avons été sommées de le fermer au risque, nous disait-on, de mettre en péril le club. Le moindre désaccord entraînant des demandes répétées de fermeture, il fallait qu’on soit d’accord, ou qu’on se taise. Nous nous sommes tues. La réponse négative adressée par le club à une journaliste qui demandait à nous parler, avant d’en décider nous-mêmes, a fait partie de cette série d’incidents qui, au final, ont empêché l’équipe féminine de prendre la parole en son nom.
Le reproche de « ne pas connaître la ligne politique » du club et de ne pas en partager les valeurs est revenu à de nombreuses reprises. La conséquence majeure de ce reproche a été immédiate : elle nous excluait de fait comme membres légitimes. On nous demandait d’attendre – que vienne notre tour, que nous soyons plus nombreuses ou jugées aptes à intervenir en tant que membres à part entière – face au refus explicite d’intégrer des questions féministes dans les luttes du club. Nous devions respecter des protocoles de validation collective régulièrement bafoués par d’autres, mais nos propositions se soldaient systématiquement par des échecs. Notre investissement de la structure du club a donc tourné court, et le verdict a été implacable : nous ne pensions qu’à notre autonomie et ne voulions pas faire l’effort de nous intégrer. Des féministes « séparatistes », en somme.
« Des meufs ingrates »
Les questions soulevées par l’arrivée de l’équipe féminine et ses revendications ont pris place dans un contexte où plusieurs membres du club tentaient de leur côté d’en fluidifier le fonctionnement, non sans difficultés. Ces intérêts communs ont permis des alliances ponctuelles mais n’ont pas résisté au manque général de dialogue et aux incompréhensions mutuelles. La crise se généralisait donc sur plusieurs fronts – celui de l’équipe féminine et celui des membres « réformistes » – mais l’équipe féminine en a payé le prix fort, collectivement et individuellement.
À l’automne 2019, la Ligue professionnelle de football a décidé de condamner les insultes homophobes en tribune en autorisant, pour cela, l’arrêt des matchs lors du championnat de football professionnel. Cette politique s’inscrivait indéniablement dans la continuité de la répression des supporter·ices par les hautes instances du football, ce qui la rendait contre-productive et difficilement acceptable. Elle a donné lieu à de nombreux débats dans lesquels des groupes de supporters refusaient de reconnaître le caractère homophobe de ces insultes. En condamnant cette homophobie sur les réseaux sociaux, je me suis retrouvée prise à partie par un membre du club, qui s’en est également pris à des ami·es extérieur·es au club. Insultes sur le physique de l’une (« jette toi stp avec ta tronche de dispensée de sport »), menaces à peine voilées à l’autre (« parle bien par contre conseil […] t’es qu’un escroc qui connaît pas son sujet […] on se croisera sans doute et on verra s’il maintient ses propos […] Paris c’est grand, le monde est petit, surtout le nôtre »), éternelles accusations de méconnaissance (« avant de critiquer ce qui se passe dans les stades de foot, peut-être faut s’y rendre et pas seulement une fois en juin pendant la coupe du monde féminine »). Il devenait difficile de prendre position sans avoir peur des conséquences, dans un contexte où la défense des supporter·ices prenait une place centrale.
Entre-temps, nous avions appris que des agressions sexistes – des violences en tribune lors d’un tournoi – avaient marqué le club par le passé. Il y avait des moqueries, des phrases prononcées – « arrête de manger si tu veux savoir courir » –, le doigt d’honneur d’un membre qui traîne encore sur la photo de groupe d’une centaine de footballeuses lors d’un événement auquel nous participions. L’atmosphère était tendue, alors que de nouvelles joueuses arrivaient peu à peu.
L’équipe féminine a enchaîné les discussions et les réunions. Nous voulions continuer à jouer. Nous avons rédigé un texte dont la dimension collective a été niée – diviser pour mieux régner : la tactique est vieille comme le monde. Il a été discuté lors d’une réunion houleuse, achevée en larmes suite aux accusations d’incompétence faites à l’une d’entre nous par un membre du club. Critiques de la gestion paternaliste du club, nous affirmions toutefois soutenir « sans réserve la lutte du [club] contre toutes les formes de discriminations » et rappelions que, selon nous, « une critique du capitalisme ne va pas sans une perspective antiraciste, féministe et queer ».
Nous demandions la possibilité de nous organiser et de communiquer en notre nom, de choisir de répondre ou non aux sollicitations de la presse, le tout en prévenant le bureau du club, avec lequel nous acceptions de discuter de nos décisions en cas de désaccord. Paye ton séparatisme. La réponse écrite d’une partie des membres, signataires rigoureusement classés par ordre d’ancienneté, réaffirmait le rejet de nos demandes. Suite à cela, l’envoi d’un message de la part de l’équipe féminine, proposant une réunion pour discuter de ces « valeurs du club » que l’on nous reprochait de ne pas connaître a été accueilli par un flot de réponses fleuries, qui allaient de « NIQUEZ VOUS » à « je paye pas la cotisation pour payer des maillots à des meufs ingrates » en passant par les accusations de « chier dans les bottes ou essayer de mettre des bâtons dans les roues » et autres « stop victimisation ». Une réunion a finalement été organisée avec des joueurs afin de discuter de la situation. La nouvelle est parvenue aux oreilles d’autres membres du club, et un message audio est arrivé sur nos téléphones. L’un d’entre eux hurlait en annonçant clairement la couleur : « Je vais venir, et je vais vous gifler. » C’est là que nous avons annoncé notre départ.
L’expérience de neuf mois s’est arrêtée ainsi, trouvant un terme là où culmine tristement un continuum sexiste familier à beaucoup d’entre nous. Où et quand commence-t-il ? À quel moment peut-on le reconnaître ? Questions difficiles, auxquelles se sont également confrontés ceux qui ont joué le rôle d’alliés, tentant de dialoguer ou refusant d’entraîner une équipe tant qu’une conversation apaisée n’était pas possible. Essayer de régler individuellement les « problèmes d’agressivité », changer l’organisation à la marge s’est révélé inutile tant que deux conditions n’étaient pas remplies : reconnaître que le problème était structurel d’une part, et faire en sorte que les alliés s’expriment en nombre et publiquement d’autre part. Dans la panique et la volonté de préserver le groupe et l’initiative dont il est porteur, chacun·e a agi selon ses croyances et sa position. Aujourd’hui, il s’agit peut-être de réfléchir à ce que cette histoire dit de nos pratiques sportives et militantes. De la difficulté de tenir ensemble un versant sportif, vecteur d’une réelle mixité sociale, et un engagement politique dont la réussite repose dès lors sur le dépassement de multiples rapports de domination. D’autres s’y sont cassé les dents, en constatant en premier lieu qu’il n’y a pas d’allié·es naturel·les.
Les divergences avec les femmes présentes dans la gestion du club avant notre arrivée, très peu nombreuses, n’ont ainsi fait que mettre en lumière toute la difficulté de la lutte féministe : nous ne sommes pas toutes d’accord entre nous pour la seule raison que nous sommes des femmes. À ce constat s’ajoutait un rapport différent aux luttes féministes et au club. Nous formions un groupe nouveau à l’intérieur de celui-ci, et voulions porter une identité politique dont les revendications apparaissaient dissonantes avec leur engagement de long terme aux côtés des équipes masculines, en tant que supportrices et gestionnaires. Nous nous sommes saisies différemment de notre condition minoritaire dans cet espace, en luttant séparément pour y conserver notre place, et selon des lignes de fracture différentes. Nous étions blanches pour la plupart et vues comme bourgeoises, ce qui disqualifiait notre discours aux yeux de certaines, au nom de l’attachement à l’enracinement populaire du club et de la lutte contre le racisme. Si la question de la hiérarchisation des luttes – que l’on nous reprochait également – est connue, il faut entendre la critique qu’elle recèle ici. Elle est révélatrice de l’état des mouvements féministes contemporains, de notre difficulté à sortir des milieux intellectuels et universitaires, du coût que les luttes féministes représentent dans des groupes autrement marginalisés et du manque général de formation autour de l’apprentissage et de la transmission de ces sujets.
Si elles émergent le plus souvent dans la douleur, les luttes féministes se construisent pourtant. Le dégoût du militantisme, assimilé à des pratiques oppressives où la formation se confond avec le devoir d’obéissance, n’empêche pas certaines convictions de se renforcer. L’expérience a durablement blessé plus d’une d’entre nous, mais elle a renforcé l’équipe féminine qui a fait front commun dans cette crise. Une fois ce combat achevé, la cohésion du groupe a été difficile à maintenir, mais elle n’est pas pour autant inexistante : la plupart d’entre nous avons continué le foot et prolongé les initiatives collectives, nous rassemblant autour d’équipes ou d’associations.
J’ai longtemps ressenti de la colère. J’ai été partagée entre l’envie de clore ce chapitre et la nécessité de reconnaître qu’il laisserait longtemps des traces sur les plans individuel et collectif. À ce titre, je ne peux m’empêcher de croire qu’il faut en parler, entre nous et autour de nous. Pour ouvrir des discussions sur nos pratiques sportives et militantes, mais aussi pour enrichir l’histoire de nos luttes et mieux les comprendre. Au détour d’un texte puissant8, Audre Lorde écrit que par le passé ses silences ne l’ont pas protégée. Et nous prévient : « Votre silence ne vous protégera pas non plus. »9
***
[1] L’Équipe, 6 mars 2013.
[2] « Comportements sexistes : dans le Tarn, 86 joueuses de foot quittent leur club », La Dépêche, 24 septembre 2019.
[3] Voir Mickaël Correia, Une histoire populaire du football, Paris, La Découverte, 2018.
[4] Sur le modèle du pink washing pour le marketing gay-friendly. La couleur violette (purple) fait référence aux luttes féministes.
[5] Les clubs de calcio popolare (foot populaire) forment un mouvement hétérogène marqué à gauche, qui se caractérise notamment par l’opposition au « foot moderne », l’actionnariat populaire, l’ancrage local et la participation active des supporter·ices à la vie du club.
[6] Le double standard désigne une inégalité de traitement entre deux groupes d’individus.
[7] « Refoulées de Argentine-Écosse au Parc des Princes pour avoir porté du vert », Huffpost, 20 juin 2019. Le vert symbolisait une campagne pour la légalisation de l’avortement en Argentine.
[8] « Transformer le silence en paroles et en actes ». Dans Sister Outsider, Genève, Mamamélis, 2003.
[9] Je remercie les personnes qui m’ont accompagnée dans la rédaction de ce texte.
+ d'articles
- N.6 hiver 2021
- PANTHÈRE
- Lucile Dumont
- Enquête et analyse, féminisme,